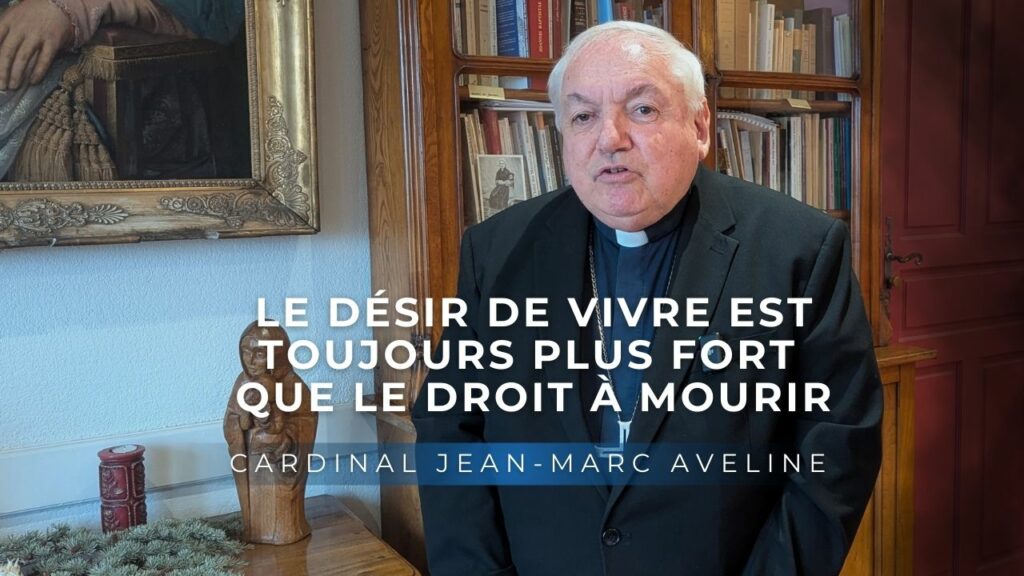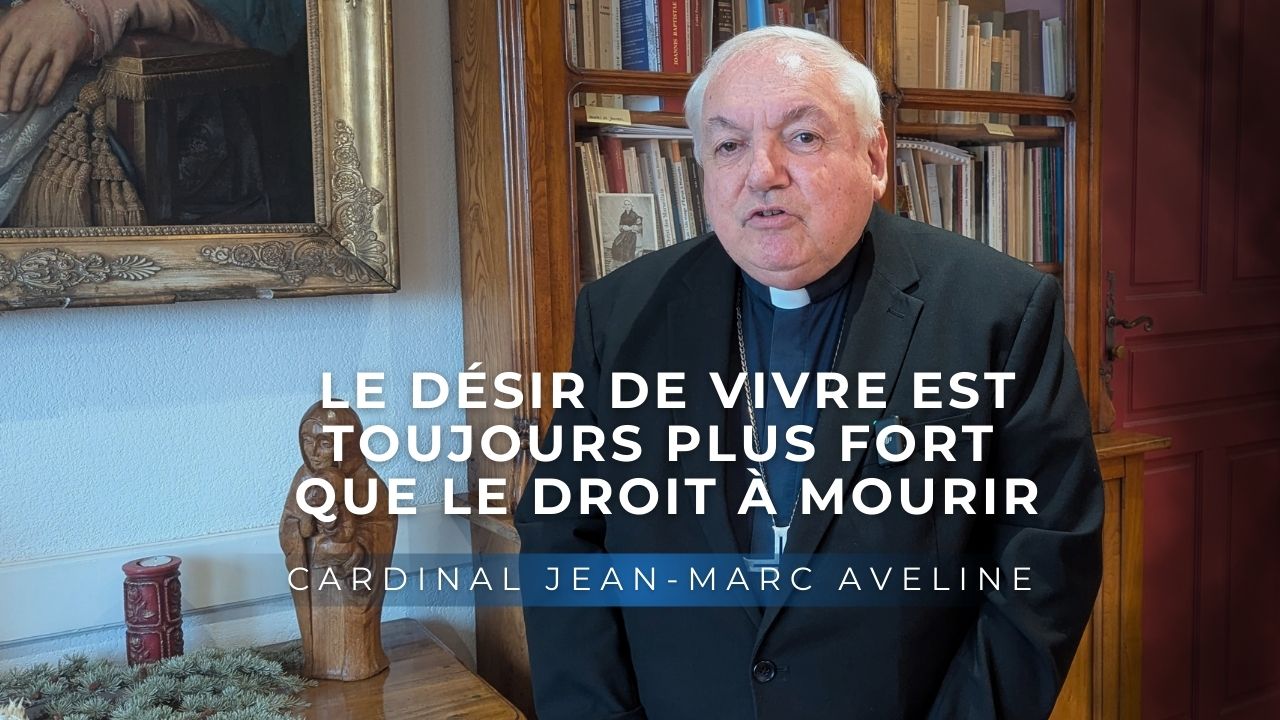Que le désir de paix nous habite !

En présence des représentants des religions juive, musulmane ou bouddhiste, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a lancé en ce début du mois de janvier, un virant appel au dialogue entre croyants, au service de la paix.
Chers amis,
Qu’elle est belle cette antique tradition des Marseillais d’accourir, dès le premier jour de l’année nouvelle, à Notre-Dame-de-la-Garde, pour rendre visite à notre Bonne Mère, lui confier leurs soucis et leurs espérances et faire appel à sa douce et puissante intercession ! Puisse ce sanctuaire voir affluer tout au long de cette année jubilaire qui commence, des pèlerins de tous âges et de toutes conditions, de toutes langues et de toutes cultures, nouveaux nés portés par leurs parents, fiancés soulevés d’espérance et jeunes mariés débordants de projets, marins venant rendre grâce ou confier leur prochain équipage, touristes, croisiéristes, et toute cette foule marseillaise bigarrée, de religions et convictions diverses, mais qu’un même élan vers le ciel conduit au sommet de cette auguste colline, venant chercher tour à tour réconfort et apaisement, consolation et espérance.
Cette année encore, l’état du monde n’est pas encourageant, comme le P. Recteur nous l’a rappelé : instabilité, incertitudes, violences, trafics, guerres, etc. Je ne tenterai pas de dresser une liste des conflits actuels, qui donnent raison à l’appellation de « guerre mondiale par morceaux », utilisée depuis plusieurs années par le pape François. Et pourtant nous sommes là, ce soir, et je vous remercie infiniment d’avoir répondu à cette invitation. Merci à tous les responsables des différents cultes présents à Marseille qui sont venus partager ici ce moment de recueillement et de prière pour la paix en ce premier jour de l’année civile, qui est aussi la Journée mondiale de prière pour la paix.
Au début des années 1980, l’écrivain Julien Green notait dans son Journal cette question déjà lancinante : « Quand donc les religions deviendront-elles enfin des traits d’union entre les êtres et non plus des raisons supplémentaires de s’exterminer ? »[1] Quarante ans ont passé et cette question reste toujours d’actualité ! À l’horloge de l’histoire, l’heure que nous vivons est grave et stimulante à la fois. Et nous savons bien que les vraies difficultés auxquelles les peuples d’aujourd’hui sont confrontés relèvent moins de leurs différences religieuses que des fossés économiques et des injustices que certains dirigeants ont laissé s’installer et grandir, soit entre les peuples soit à l’intérieur même de chaque peuple.
Il y a aujourd’hui des idolâtries qu’il importe de dénoncer. Car nous savons bien que l’attitude idolâtre n’est pas réservée au domaine du religieux : elle concerne bon nombre d’idéologies, du nationalisme exacerbé jusqu’à l’eugénisme libéral en passant par toutes formes de fondamentalismes plus ou moins teintés de religieux. Dans le contexte international actuel, l’idolâtrie peut s’appeler « croissance » lorsqu’elle entraîne sous cette bannière toutes sortes d’injustices sociales, ou bien s’appeler « contrôle des ressources énergétiques » lorsqu’elle cache sous cet objectif des pratiques qui bafouent le droit des peuples, ou encore s’appeler « sécurité » lorsqu’elle véhicule sous ce nom un cortège de peurs et d’exclusions, notamment à l’égard des personnes migrantes.
Si les religions ont à mes yeux quelque chose à dire aujourd’hui, c’est sous la forme critique et prophétique qu’il leur faudra s’exprimer. Si elles ne font que redire ce que tout le monde dit déjà, mieux vaut qu’elles se taisent ! Mais elles ont une parole à prononcer, et il me semble que cette parole sera d’autant plus forte qu’elle aura été passée au crible de la prière et de l’expérience spirituelle dont notre monde a tant besoin. C’est la raison pour laquelle il importe que chaque religion développe en son sein un travail sur elle-même qui lui permette d’entrer en vérité et pas seulement en superficialité, dans l’exigeante et passionnante expérience du dialogue. Il y a là un défi pour chacun de nous, responsables des différents cultes à Marseille. Car ce n’est pas parce que nous sommes présents ce soir que cela signifierait que tous nos fidèles soient d’accord avec nous sur l’opportunité d’un tel rassemblement œcuménique et interreligieux pour la paix ! Même parmi les fidèles de la religion à laquelle j’appartiens !
Il est vrai que c’est difficile. En effet, admettre, comme le disait et le répétait saint Jean-Paul II, que « Toute prière authentique est inspirée par l’Esprit, qui est mystérieusement présent dans chaque cœur humain »[2], et que nous pouvons tous avoir besoin de la prière des autres, voilà pour tout croyant l’un des grands défis de l’expérience du dialogue. Et pourtant, « On découvre Dieu dans la rencontre qu’il suscite », comme l’enseignait jadis le jésuite français Michel de Certeau.[3] Et c’est là surtout, en tant qu’expérience d’un Dieu qui se révèle « dans la rencontre qu’il suscite », que le dialogue interreligieux est une chance pour la paix. Car la paix intérieure procède de cet abandon confiant qui cherche à discerner la présence cachée du divin dans l’épaisseur de nos différences humaines. « La paix est un don de Dieu et il faut l’obtenir de Lui par la prière de tous », disait Jean-Paul II en commentant la journée d’Assise (22 décembre 1986).
Chers amis, le dialogue, comme la paix, est chose précaire. Comme elle, il comporte pour qui veut y travailler une exigence de conversion intérieure, qui passe par le refus des autojustifications qui conduisent à la guerre et par l’écoute attentive de la précarité de l’autre. C’est cette sensibilité à la précarité qui oblige à dénoncer tous ces jeux de pouvoir d’où naissent les guerres. La voie est difficile : un pacifisme idéaliste n’est pas plus sensible à la précarité qu’un bellicisme radical. Pour ma part, je puis témoigner que les chrétiens d’aujourd’hui se retrouvent proches non seulement des croyants d’autres traditions religieuses mais aussi de tout homme, de toute femme, croyant ou non, qui fait en vérité l’expérience de la vie et cherche à sa façon le bien de l’humanité. Ensemble, ils peuvent trouver ce qui est universel à l’espérance humaine et que traduisent les mots de paix, de justice, d’amour et de vérité.[4] Mais chacun les exprime avec la mémoire de son peuple, avec ses symboles culturels ou religieux, avec le souvenir dangereux des victimes de son histoire qui contribuent à définir son identité ! Nous sommes responsables d’entretenir dans la société d’aujourd’hui, prompte à faire la sourde oreille dès que les intérêts économiques de quelques-uns sont en jeu, la mémoire interpellante de l’histoire des vaincus de l’absence de dialogue !
Chemin faisant, chaque acteur du dialogue s’aperçoit que la rencontre avec des personnes qui, de manière tout-à-fait sincère et respectable, vivent et croient autrement que lui, peut l’aider à mieux comprendre ce qu’il croit, mieux encore qu’il n’avait cru l’avoir compris ! Il ne s’agit pas d’abandonner ce que l’on croit, mais d’apprendre à le comprendre mieux dans (et grâce à) la relation à l’autre. Je suis persuadé que les jeunes d’aujourd’hui attendent des religions qu’elles leur montrent ce chemin, celui du respect de l’autre et du désir de paix, celui du combat contre l’injustice et la pauvreté, celui de l’interpellation prophétique et de la défense du plus faible, celui du pardon et de la réconciliation, celui de la joie de croire qui peut donner tant de goût à la vie…
C’est ma prière ce soir. Que le dialogue entre les croyants de différentes religions montre prophétiquement qu’il est possible de bâtir la paix entre les peuples ! Que ce désir de paix nous habite tous, croyants ou non ! Que nous apprenions humblement à recevoir les uns des autres, dans le dialogue de nos fidélités à des normes de foi différentes ! Que ce désir de paix nous habite tous, qu’il éclaire nos actes et soit à la racine de notre joie ! Tel est le vœu que je formule à l’égard de chacune et chacun d’entre vous, en communion avec mes frères et sœurs des diverses religions présentes à Marseille.
Bonne année à tous !
+ Jean-Marc Aveline
Notre-Dame-de-la-Garde
Mercredi 1er janvier 2025
Prière pour la paix
[1] Julien GREEN, La lumière du monde (Journal 1978-1981), Paris, Seuil, 1983, p. 99.
[2] Notamment à l’occasion de la Journée de pèlerinage, de jeûne et de prière pour la paix à Assise, le 27 octobre 1986.
[3] Cf. Michel de CERTEAU, « La conversion du missionnaire », Christus 1963.
[4] Cf. l’encyclique de Jean XXIII, Pacem in terris, publiée en 1963.
Publié le 03 janvier 2025 dans A la une, Homélies de Mgr Jean-Marc Aveline
Ces articles peuvent vous intéresser
Le désir de vivre est toujours plus fort que le droit à mourir
Le cardinal Jean-Marc Aveline, Président de la Conférence des évêques de France,…
On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort
Alors que le Sénat va examiner la proposition de loi instituant un…
Le cardinal Aveline, la Méditerranée en mosaïque
L’histoire du cardinal Aveline est intimement liée à la Méditerranée. Né le…
en ce moment
à Marseille